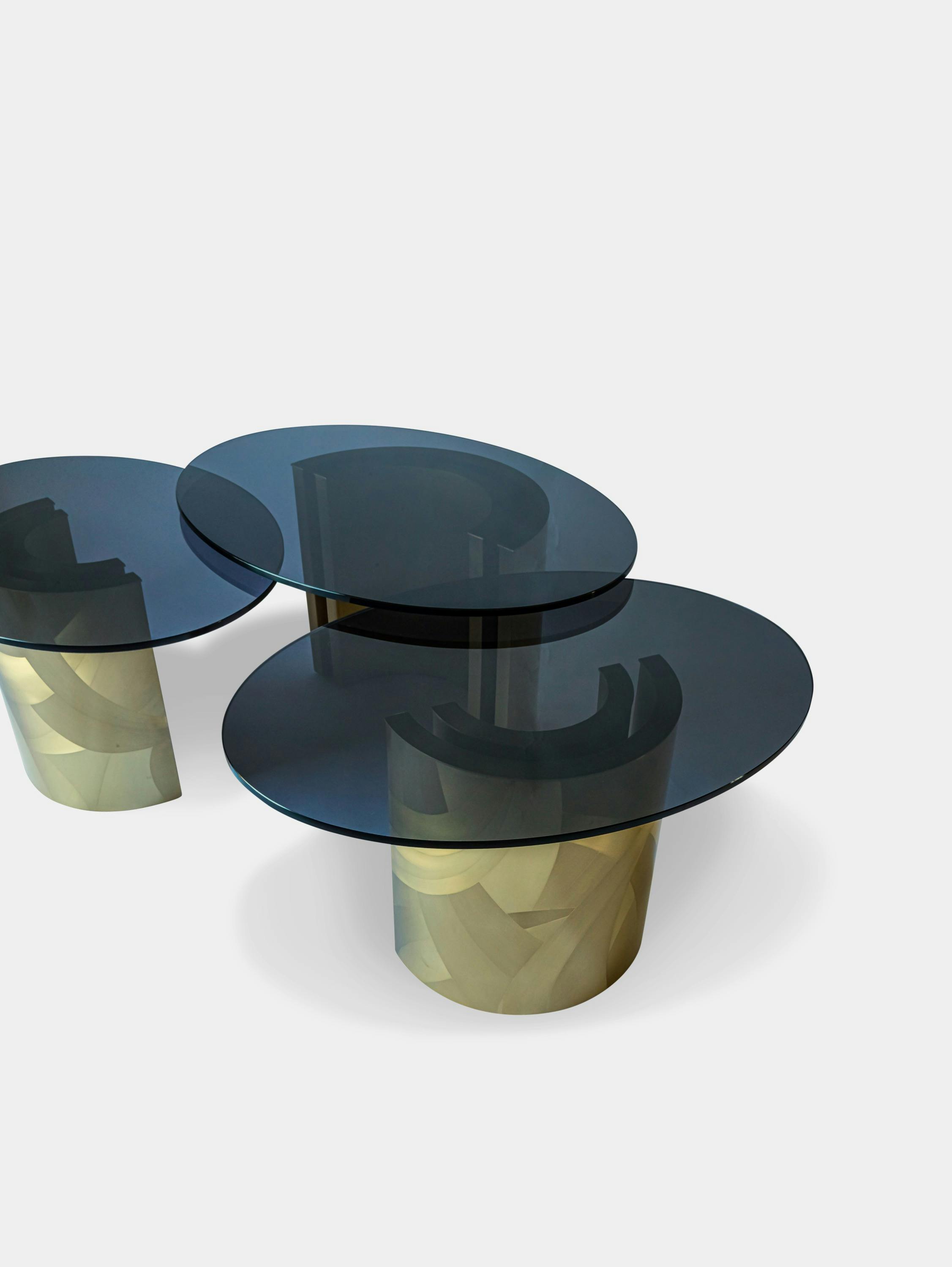Dans la tradition classique, avant le XXe siècle, les décors intérieurs étaient ainsi souvent envisagés par l’architecte, avec l’aide de l’ornemaniste. Spécialisé dans le dessin des ornements qui sont l’alphabet du style, celui-ci venait ainsi ajouter cette touche particulière sur le décor intérieur, boiseries, marbres, stucs ou peinture, en intégrant tout le répertoire correspondant. Trophées, soleils ou mascarons pour le style Louis XIV, coquilles et instruments de musique pour le Louis XV, bergers et rubans pour le Louis XVI, ou encore aigles, cygnes ou abeilles pour l’Empire. Chaque corps de métier intervenait ensuite pour sa partie : tapissiers, menuisiers ou encore ébénistes pour le mobilier, avec une influence souvent prédominante du tapissier, parfois appelé tapissier – décorateur.
Tout à son éclectisme revisitant les grands styles des siècles précédents, le XIXème siècle ne vient pas foncièrement changer la donne. Tout au plus consacre-t-il le règne des antiquités, logique dans une époque où triomphe le goût de l’ancien, du néo-Renaissance au néo-Louis XVI, en passant par le néo-Gothique. A l’aube du XXe siècle, influencé par le mouvement Arts and Crafts et l’art total qu’est l’Art nouveau, la mode évolue vers les ensembles décoratifs. Dès la fin du siècle précèdent, Jules Simon rapportait ainsi dans son rapport sur l’Exposition de 1878 que les fabricants de meubles anglais, au lieu de présenter leurs créations meubles par meubles, aménageaient des pièces entières : «Ils poussent le souci de l'ensemble, jusqu'à placer sur l'étagère d'un salon des cristaux et porcelaines »